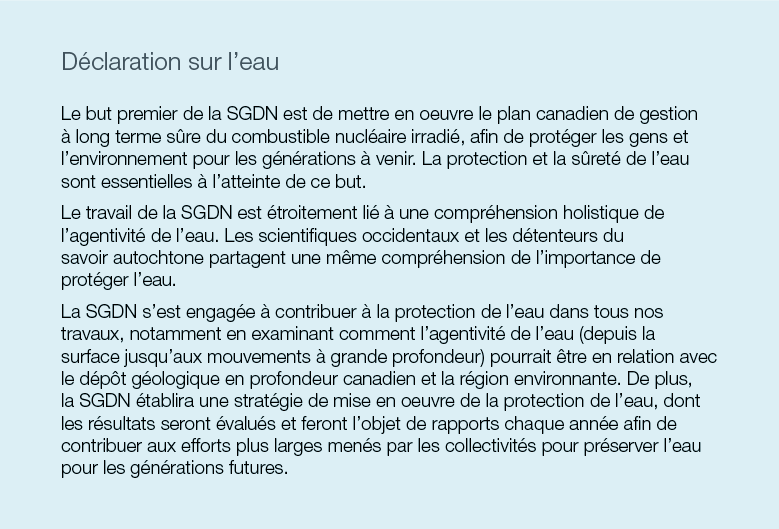Protéger l’eau ensemble
En savoir plus
Notre engagement à protéger l’eau
La SGDN comprend l’importance de l’eau et la nécessité de la protéger pour les générations à venir. La protection de l’eau est au cœur de tout ce que nous faisons et est un engagement que nous partageons avec les Canadiens et les peuples autochtones. Dans le cadre de cet engagement commun, nous soutenons et finançons tout un ensemble de projets qui font progresser notre compréhension de l’eau, contribuent à la conservation des espèces aquatiques et des habitats locaux, aident financièrement des personnes à améliorer leurs puits artésiens et participent aux efforts de conservation de l’eau et de préservation des berges.
Dans l'esprit de l’engagement que nous partageons avec les Canadiens et les peuples autochtones, la SGDN ne procédera à la construction d’un dépôt géologique en profondeur qu’avec le consentement de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake et du Canton d’Ignace, ou avec le consentement de la Nation ojibwée de Saugeen et de la Municipalité de South Bruce.
Notre Déclaration sur l’eau
Depuis notre création en 2002, la collaboration avec les collectivités a toujours été au coeur de la planification de la SGDN. Au fil de discussions tenues avec les Canadiens et les peuples autochtones, la SGDN a identifié un thème commun parmi les questions que nous avons reçues, à savoir la manière dont le projet protégera l’eau. Parmi les divers moyens que nous avons utilisés pour souligner l’importance de ce travail, nous avons décidé de publier une Déclaration sur l’eau, qui explique que la raison d’être même du plan de gestion du combustible nucléaire irradié est de protéger les gens et l’environnement, y compris l’eau.
Documents
Deux systèmes de connaissances
Les deux sites envisagés dans le cadre du plan canadien éloigneraient davantage le combustible nucléaire irradié des grandes étendues d’eau, y compris des Grands Lacs, par rapport aux endroits où il est actuellement en grande partie entreposé. La conception du dépôt mise sur un ensemble de barrières qui se conjugueront pour confiner le combustible nucléaire irradié et l’isoler des gens et de l’environnement, notamment de l’eau. Le dépôt serait situé à une profondeur où la géologie est également déconnectée des bassins hydrographiques (en d’autres termes, de l’eau que nous voyons et utilisons), et ce depuis des millions ou des milliards d’années.
En nous appuyant sur deux systèmes de connaissances — la science occidentale et le savoir autochtone — nous en apprenons tous davantage sur la mesure dans laquelle l’eau assure notre subsistance, sur la grande importance culturelle qu’a l’eau pour les peuples autochtones et sur les liens personnels que nous avons tous avec l’eau.
La science occidentale
Les deux sites envisagés pour un dépôt géologique en profondeur sont plus éloignés des grandes étendues d’eau que de nombreux sites actuels de stockage du combustible nucléaire irradié au Canada.
À la profondeur où le dépôt géologique en profondeur proposé sera construit, il y a très peu d’eau. Le dépôt confinera le combustible nucléaire irradié et l’isolera de l’eau et des milieux environnants au moyen de multiples barrières.
L’une de ces barrières est la roche elle-même. La roche située à la profondeur du dépôt — qui correspond à peu près à la hauteur de la Tour CN ou même davantage — est isolée des bassins hydrographiques. L’eau souterraine à cette grande profondeur a été essentiellement déconnectée de l’eau que nous observons en surface depuis des millions, voire des milliards d’années.
L’argile bentonitique est une autre barrière. L’argile bentonitique est une matière naturelle dont l’étanchéité à l’eau a été démontrée. C’est une matière qui se gonfle au contact de l’eau, une propriété qui la rend particulièrement imperméable. Elle est également très stable, comme le confirment les observations faites dans des formations naturelles vieilles de centaines de millions d’années.
Nous prévoyons également de recouvrir d’un fin revêtement de cuivre les conteneurs de combustible nucléaire irradié en acier, dont les propriétés mécaniques leur permettront de résister aux pressions exercées par les plus de 500 mètres de roche sus-jacente et par des glaciers de trois kilomètres d’épaisseur qui pourraient recouvrir le sol lors d’une éventuelle période glaciaire. Le cuivre est un matériau naturel reconnu pour être très durable dans les conditions géologiques qui existent à grande profondeur et pour sa résistance à la corrosion. La SGDN a publié des constatations qui démontrent que le revêtement en cuivre de nos conteneurs de combustible irradié est suffisamment robuste et épais pour résister à tout effet corrosif pendant plus de 1 000 000 d’années. Du minerai de cuivre naturellement pur a été extrait autour de la région des Grands Lacs. Les collectivités autochtones ont exploré des gisements de cuivre dans la même région pendant des milliers d’années et ont amassé des connaissances traditionnelles locales substantielles à leur sujet.
Le savoir autochtone
Les peuples autochtones considèrent l’eau comme un lien vital qui nous unit à notre mère la Terre. Il est donc important que notre travail protège cette Terre Mère et l’eau. Dans la vision du monde que se font les peuples autochtones, tout ce que notre mère la Terre a créé, y compris l’eau, possède un esprit et est considéré comme un être vivant. La SGDN comprend et respecte cette croyance importante, et nous sommes résolus à protéger l’eau et les collectivités qui l’entourent.
Nous travaillons avec les collectivités, y compris les détenteurs du savoir autochtone, pour faire en sorte que notre travail soit guidé par la responsabilité de protéger les gens et l’environnement, y compris l’eau, et ce pour les générations à venir.
Comprendre l'eau et son rôle dans le plan canadien
Regarder maintenant
Nous sommes des intendants de l’eau
Rencontrez Jessica Perritt, intendant de l'eau et Gestionnaire, savoir autochtone et réconciliation
Regarder maintenant
Rencontrez Bob Hanner, intendant de l'eau et professeur de biologie intégrative à l'Université de Guelph
Regarder maintenant
Recontrez Joanne Jacyk, intendante de l'eau et directrice de la sélection d’un site pour la région Ignace/Nord-Ouest
Regarder maintenant